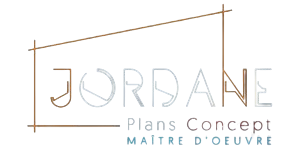Chaque année, la France voit disparaître entre 20 000 et 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles et forestiers en raison des activités humaines.
L’étalement urbain, l’extension des infrastructures et la bétonisation contribuent à l’artificialisation des sols, un phénomène majeur de la perte de biodiversité.

Quelles sont les conséquences de l’artificialisation des sols ?
- Amplification des riques d’inondations
- Perte de la biodiversité
- Réchauffement climatique
- Pollutions
- Réduction de la capacité des terres agricoles à nous nourrir
- Renforcement des îlots de chaleur en zone urbaine
Quels sont les leviers pour mieux protéger les sols de l’artificialisation ?
La loi « Climat et résilience » du 22 août 2021 a posé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l’horizon de 2050.
Cette loi vise à mieux prendre en compte les conséquences environnementales lors de la construction et de l’aménagement des sols, sans pour autant négliger les besoins des territoires en matière de logements, d’infrastructures et d’activités.
Dans le Journal officiel du 28 novembre 2023, trois décrets d’application de la loi Climat et résilience ont été publiés :
- le décret relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols précise notamment ce que recouvre la notion de surface artificialisée ;
- le décret relatif à la territorialisation des objectifs de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols ajuste les objectifs de mise en oeuvre de la sobriété foncière en tenant compte notamment des modifications apportées par la loi du 20 juillet 2023 ;
- le décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l’artificialisation des sols. Cette commission, instituée par la loi du 20 juillet 2023, interviendra en cas de désaccord ente l’État et la région concernée par de grands projets d’infrastructures.
L’artificialisation des sols, une notion intégrée au code de l’urbanisme
Le plan ZAN vise à « renaturaliser » un espace pour chaque espace artificialisé. Mais la détermination artificiel ou non-artificiel fait encore débat.
Une approche quantitative, l’augmentation de la superficie des sols artificialisés à l’échelle d’un territoire au détriment des espaces naturels. Une apporche qualitative, la transformation des caractéristiques d’un sol naturel et ses effets sur l’environnement.
C’est un phénomène qui consiste à « transformer un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’aménagment pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affecter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, infrastrutures, … « , selon le ministère de la transition et de la cohésion des territoires.
Cette définition revient à considérer comme artificialisés tous les sols qui ne sont pas des espaces naturels, agricoles ou forestiers, qu’ils soient imperméabilisés (bâtis, revêtus et stabilisés comme les routes, les voies ferrées, les parkings…) ou perméables (comme les parcs et jardins, les friches urbaines, les terrains de sport, les carrières…). Elle ne permet pas de distinguer le degré d’imperméabilisation des sols ou l’impact sur la biodiversité.
Des aides financières
La réforme en cours a pour objectif de favoriser l’utilisation des surfaces déjà artificialisées par la densification urbaine.
Toutefois, encourager cette densification implique également, en terme d’acceptabilité sociale, de favoriser la qualité urbaine et un certain retour de la nature dans les villes.